


Les Aventures de Baligand
Aventures de mer
Castanha do Brasil ou tout ce qu’il faut éviter de faire
A Salvador, l’accent traîne langoureusement sur un mot qui résonne comme une déclaration d’amour, O Brasil. Amour des Bahianais pour leur pays et amour tout court, car ils sont chauds ces latinos.
Chauds sur les plages où garçons et filles exposent fièrement biceps, poitrines, fesses et tatouages.
Chauds dans la rue où les filles suivent de près la dernière mode inspirée des sacro saintes télénovelas.
Chauds sur les routes en mauvais état et encombrées de camions à la conduite assassine, le permis de conduire tenant ici plutôt du permis de port d’arme.
Chauds enfin partout en ville où des policiers lourdement armés et prompts à jouer du flingue sont omniprésents.
Or donc voici deux voileux déambulant nez en l’air dans Comercio, le quartier des affaires, très animé la journée, mort et mortel le soir. Mais bon, de jour il y a tellement de monde, pourquoi se tracasser. Erreur.
Un visage se glisse à la hauteur d’Odette, un cri… Tout de suite je comprends. “Que t’a-t-il pris ?” - “Mon collier” - “Tudieu !”. La tête d’or et d’émeraudes du Seigneur de Sipan achetée à Cuzco-Pérou. Irremplaçable.
Sus au voleur qui déjà se fraye un chemin à travers la foule. Chance, il tombe, lâche le collier, le ramasse. Tel Bob Morane contre tous les chacals, je lui tombe dessus, alors qu’il entame un gymkhana dans le trafic et j’arrive à le plaquer contre un bus. Belle occasion de prendre la mesure de l’animal, plus grand, plus fort, plus jeune. Il se dégage donc vite fait.
Oui mais le héros est en rage. La poursuite continue à travers la ville basse, le marché, les petites ruelles. Aucune idée où je suis. Tant que je reste a ses trousses, il doit continuer à courir et donc à attirer enfin l’attention des flics qui n’en demandent pas tant. Au grand galop, ils dépassent Bob Morane vieillissant et rattrapent le voleur épuisé qu’ils cernent tous flingues dehors et le collent sans ménagement contre le mur.
D’un geste furtif, le malandrin glisse son butin en bouche, ce que je fais comprendre aux pandores qui lui font recracher ses dents, ses amygdales et la chaîne du collier mais pas le pendentif qu’il a du avaler. Quelle avanie pour le Seigneur de Sipan quand il ressortira.
Les flics sont aux anges. Un flag. Plus question de nous lâcher, ils veulent notre déposition. Le temps de récupérer Odette, heureuse de retrouver son héros entier, mais sans le pendentif et hop nous voici fourrés dans une minuscule bagnole déglinguée en compagnie de trois flics énormes, engoncés dans leur gilet pare-balles, qui nous compressent pour faire entrer leurs fusils à pompe.
Notre voleur a été flanqué dans le coffre d’où il gémit son innocence. Les flics rigolent. Destination la Delegacia, un local délabré où les prises du jour, alignées à même le sol, menottes au poing, attendent résignées. Triste spectacle.
Notre voleur, continue de gémir à deux pas de nous, certes menotté dans le dos, mais quand même… pas rassurant. Trois heures pour prendre notre déclaration, rédigée en portugais et donc parfaitement incompréhensible. On peut quand même y deviner que notre ami s’appelle Jésus Dos Santos, pas vraiment un patronyme adapté a sa spécialité, qu’il a 34 ans et a déjà fait dix ans de prison.
Comme ici un meurtre va en général chercher dans les quatre ans, autant dire que ce n’est probablement pas un tendre. Pour l’heure il n’est pas heureux, mais risque de s’en sortir sans autre forme de procès que de sérieuses douleurs lombaires car le surpeuplement carcéral classe ce genre de cas sans suite mais pas sans conséquences pour la santé de l’intéressé. Les flics ont la matraque lourde.
Cet épisode, le premier en huit ans de tour du monde, n’est pas de nature à ternir notre image du pays. Après tout il était stupide d’arborer un bijou de valeur dans ce quartier de mauvaise réputation. Oui mais, pire nous attendait dans la capitale de l’Etat de Bahia…
Barra, quartier branché, coincé entre les anciens forts portugais et les plages où richesse et misère se côtoient de la manière la plus ostentatoire. C’est ici que la réalité brésilienne colle le mieux à son image, comme nous l’allons découvrir a nos dépens.
Nous avons récupéré Frédéric, le fils d’Odette à l’aéroport et l’emmenons dîner à Barra dans l’ambiance chaude de la fête nationale brésilienne. L’idée est d’aller ensuite dans le parc voisin et d’escalader la petite butte au sommet de laquelle un Christ ouvre ses bras sur les plages et les lumières de la ville. Cette initiative est entièrement mienne et entièrement stupide.
Il est 21 heures, la plate-forme aux pieds du Christ est déserte, l'endroit est sombre, nous admirons la vue. Soudain trois hommes, apparus de nulle part, se ruent sur nous sans proférer un mot.
Violence pure, glaciale, terrifiante. Pas d'autre choix que la bagarre. Frédéric s'en tire avec l'arcade sourcilière et une pommette éclatées. Welcome to Brazil. Un œuf de pigeon gonfle à l'arrière de mon crâne, c’est plus gênant que les raideurs et les écorchures. Sur le corps bronzé d’Odette, des bleus fleurissent partout et une immense frayeur l’envahit.
Elle mettra longtemps à récupérer. Elle a été jetée à terre et pendant que deux des malfrats nous agressaient individuellement, le troisième s'occupait d'elle et de son sac. Lorsqu'il est parvenu à le lui arracher, tous se sont enfuis. Gros coup de chance, ils n'étaient pas armés mais, franchement, la protection du Christ les bras en croix … cela ne marche pas.
Philippe à Salvador – Septembre 2009
Ces deux aventures arrivées à mes amis de Baligand n’auraient jamais du être narrées, car mes expérimentés camarades Odette et Philippe achèvent un long tour du monde. Porter des bijoux au Brésil et particulièrement à Salvador est prohibé. Se promener la nuit dans un endroit isolé l’est tout autant. Courir derrière un agresseur l’est encore plus. Philippe m’a avoué n’en tirer aucune gloire. Il est surprenant que le gars n’ait pas de poignard. Ces aventures qui heureusement finissent bien, ne trouvent leur place ici que comme contre-exemple. La plupart des navigateurs qui évitent scrupuleusement de prendre des risques ne prennent que du bon temps et pas de mauvais vent.
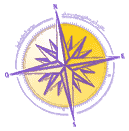




Brasil - Argentina : BALIGAND passe de la samba au tango
Aéroport de Rio, 5 heures du matin. Un chauffeur attend pancarte à la main pour m'emmener à la marina de Bracuhy distante de 250 kilomètres. Délicate attention due à la générosité de Carlos Macedo Da Costa, ci-devant secrétaire de la mairie de Volta Redonda, une commune coincée dans les montagnes de l'arrière-pays. Je le connais à peine…
En fait l'histoire est assez tordue, à l'image du Brésil, et vaut la peine d'être contée. Carlos m'avait été présenté par Pierre, un Français rencontré à Salvador de Bahia où il s'est lancé dans la construction d'une grande marina du côté de la baie d'Araratu.
Inutile de dire que pour mener à bien un tel projet, il faut pouvoir mettre dans son jeu un certain nombre de poissons pilotes bien introduits. Rien qui puisse effrayer Pierre qui mène de front deux vies parallèles, commutant chaque mois entre la France et le Brésil.
En quittant Salvador de Bahia, je l'avais déjà rangé au rang de ces rencontres intéressantes et éphémères qui parcourent notre périple. Erreur, le revoilou à Bracuhy où est amarré son voilier amené de France et passé depuis sous pavillon brésilien par un tour de passe-passe bien dans l'esprit local.
Entre en scène son poisson pilote, l'ami Carlos, qui possède à Bracuhy une seconde résidence et un yacht. Celui-ci va s'enquérir avec insistance de Baligand sans que je puisse déterminer l'objet réel de son intérêt, d'autant qu'à la mode brésilienne, il est hermétique à toute autre langue que le portugais.
Quoiqu'il en soit, en quittant Bracuhy, je laisse Baligand aux bons soins du marinero de Pierre que Carlos m'avait promis de surveiller. Par précaution supplémentaire, mon ami Philippe (celui du restaurant Estancia del Puerto) en qui j'avais bien d'avantage confiance, me promit de garder un œil sur tout ce petit monde.
A ma grande surprise, pendant mon séjour en Europe, Carlos me contacte pour m'avertir que Pierre a remonté son bateau, marinero compris, à Salvador de Bahia et propose de reprendre en charge l'entretien de Baligand, ainsi délaissé, tout en insistant pour organiser mon transport depuis l'aéroport.
A l'arrivée à la marina, c'est un ami de toujours que je rencontre. Abraços, remise en mains du bateau lavé nickel et, le lendemain, nouvelle visite d'un Carlos complètement bourré qui m'assure de son amitié éternelle, m'offre l'usage illimité de sa villa, de son épouse, me présente les clefs de sa voiture, m'invite chez lui dans la montagne. La bouteille d'armagnac que je le lui avais offerte en remerciement avait manifestement fait effet. Quand je parviendrai enfin à le remettre vacillant sur le ponton, il partira avec ses secrets – son adresse, les clefs de sa voiture et tout moyen de le contacter – et plus jamais je ne le reverrai !
Sur ces entrefaites, mes équipiers sont arrivés.
A ma droite, Dustin un jeune américain de l'Oregon. Sorti des études, il a travaillé deux ans pour une banque engluée dans la crise des sub-primes, se chargeant de liquider quelques 400 maisons dont elle s'était retrouvée la malheureuse détentrice. Dustin va rénover, louer, liquider ce portefeuille pour in fine se garder quatre propriétés de choix qu'il va mettre en location. Doté de cette source de revenus, il décide de prendre une année sabbatique à la découverte de son continent. Quoique sans grande expérience de la navigation, son enthousiasme et sa débrouillardise vont me convaincre de le prendre à bord, un choix qui se révèlera excellent.
A ma gauche, Marcos Escobar, un Paulista. Déjà le nom…il y avait de quoi se méfier. La cinquantaine resplendissante, grand, athlétique, une concurrence redoutable auprès des dames. Deux passions l'animent : les femmes et le foot. Et il se dit bon connaisseur de la côte que nous allons descendre. En fait, Marcos connaîtra deux moments de gloire. Au départ, lorsqu'il convaincra le mécano local de s'occuper en urgence du turbo, qui comme d'habitude après plusieurs mois à l'arrêt, refusait d'entrer en fonction, et à l'arrivée lorsque ses lamentations viendront a bout du marinero du Yacht Club Argentino qui nous barrait l'accès à la marina. «Pleurer jusqu'à obtenir satisfaction» nous expliquera-t-il en riant «c'est la méthode brésilienne».
A son crédit, il convient aussi d'ajouter l'explication du mystère Carlos. Lui ayant détaillé l'attitude surprenante de celui-ci, Marcos éclate de rire et explique que c'est typique. Quand un brésilien vous balance son amitié éternelle et insiste pour faire sa maison vôtre, il ne faut surtout pas y ajouter foi. Déception garantie à celui qui prendrait ces déclarations au pied de la lettre. Non, tout est dans la formule, pas dans l'intention. Par contre s'il peut se prévaloir d'un geste de grandeur gratuit, en l'occurrence aux frais de la commune de Volta Redonda, qui établisse sa puissance et votre dépendance, alors il n'hésite pas. Evidemment une fois le mode d'emploi connu, tout paraît plus clair.
Entre ces deux grands moments, Marcos sera surtout aux abonnés absents, soit abattu par le mal de mer, soit terrorisé par les événements. Soyons de bon compte, quand ces deux circonstances lui laissèrent quelque répit, il nous réalisa aussi quelques délicatesses culinaires.
Début mars 2010, c'est bientôt l'automne austral, c'est tard dans la saison pour entreprendre la route de 1.000 nautiques vers le sud-ouest et Buenos-Aires. Plus nous allons descendre, plus le risque augmentera de rencontrer les fronts qui génèrent vents contraires et mer grosse. En chemin plusieurs possibilités de refuge existent. Santos, le port de Sao Paulo et Ilha Bela mais c'est à deux pas du départ. L'île de Santa Catarina et Florianopolis à 350 Nm, Rio Grande do Sul au pied de l'immense lagune où se niche Porto Alegre 330 Nm plus loin, puis 220 Nm plus bas : Punta del Este qui marque l'entrée du Rio de la Plata.
Ce trajet est parcouru d'un courant favorable qui par moment atteint deux nœuds. En naviguant assez bien au large pour aller chercher un vent faible au départ, nous arrivons à nous glisser entre les dépressions de Sud et à réaliser le parcours en sept jours sans marquer aucune escale, mais avec quelques émotions tout de même...
Neuf mars, minuit, 20 nœuds de vent, il est temps de démarrer le générateur pour recharger les batteries. Rien, nada, pas un bruit ne sort de la cale. Batterie moteur morte. Le temps de la déconnecter, de séparer deux batteries de service et utiliser l'une d'elle pour redonner vie au générateur, je constate que la vitesse du bateau est tombée à zéro. L'autre moteur, le génois, est à l'eau et flotte a la traîne.
Ruée sur le pont pour ramener a bord la précieuse voile et constater qu'elle n'a subi d'autre dégât que la rupture par usure du point de drisse. Oui mais la tête de drisse est restée coincée en haut de l'étai et sans elle, impossible de renvoyer la voile. La nuit est noire, le trafic alentour intense. Une seule solution grimper au sommet du mât.
Déjà, sur le pont, vent et houle secouent pas mal, alors vingt et un mètres plus haut… Dustin se porte volontaire « Tu es sûr ?» lui demande-je hypocritement, soulagé de ne pas devoir me taper la corvée « Oui ça paraît cool » « Bon si c'est cool » La grimpette se passe sans anicroche jusqu'au niveau de la lampe de pont brillamment éclairée quand retentit un cri d'effroi. Dustin vient de réaliser que la lampe qu'il croyait être au sommet du mât n'en est qu'à la moitié et qu'il reste autant à grimper dans le noir absolu. Trop tard pour changer d'avis !
Heureusement Dustin, qui pratique la lutte sportive, est costaud. Tout en résistant aux mouvements du mât qui tel un bronco en furie, essaye de le désarçonner, il parvient à faire redescendre la tête de drisse. Une heure plus tard tout est à poste et Baligand est à nouveau manœuvrable. L'adrénaline peut enfin descendre et quelques bières monter.
Le lendemain matin, nous découvrons l'embouchure du Rio de la Plata. A 118 Nm de large du Cabo San Antonio en Argentine à Punta del Este en Uruguay, le doute n'est pas permis car l'eau prend une teinte distinctement caca, ici ils disent couleur bronze, ce qui revient donc bien au même.
La remontée de 180 Nm jusqu'à Buenos Aires est difficile. Hauts-fonds et épaves cernent le chenal qu'il est impératif de suivre mais point trop car le trafic est intensissime.
A l'arrivée à Baires, comme ils disent, le comité d'accueil nous a oublié. Deux options sont possibles. Soit les darses de Puerto Madero au-delà d'un pont tournant. Oui mais « moi marinero, capitan absent, revenez un autre jour… » Soit le Yacht Club Argentino claquemuré derrière un barrage flottant destiné à bloquer les jacinthes d'eau et où l'irresponsable de service nous la joue « Désolé complet ». En dehors de cela rien. Pas de ponton d'attente, pas de possibilité de mouiller. Après sept jours de mer, c'est sympa. Heureusement Marcos nous fait son numéro de pleureuse en «portuñol»…
Le Yacht Club Argentino qui se la joue vieille Angleterre à une sacrée gueule. Club house serti d'acajou, jacket requise pour dîner, cloche de bronze pour saluer les évènements d'importance et bien sur authentiques canons pour les départs de régates. Car nous sommes ici en pays de voileux habitués à affronter les eaux du Rio de la Plata, ses hauts-fonds et ses tempêtes soudaines, les Pamperos.
Les destinations habituelles sont Colonia de Sacramento en Uruguay à 25 Nm en face et Mar del Plata à 300 Nm sur la côte atlantique. La région foisonne de marinas, pour la plupart disséminées dans les méandres du delta, mais malheureusement, elles sont soit privées, soit complètes, soit inaccessibles à notre tirant d'eau. Or si l'YCA nous offre aimablement sept jours de « cortesia », au-delà nous sommes priés d'aller voir ailleurs.
Entre en scène Juan Carlos. Il est représentant B&G pour l'Amérique latine et à l'occasion skipper professionnel sur le circuit chilien. Rencontre fortuite comme d'habitude. Alors que nous déambulions en soirée dans les ruelles du centre, nous le trouvons en compagnie du skipper irlandais d'un méga-yacht rencontré à Bracuhy avec qui nous avions sympathisé.
Juan Carlos va se charger de tout. Nous trouver une place inespérée au Centro Naval Nuñez, nous y guider à marée très haute à travers des eaux vraiment basses et s'occuper de négocier fournitures et travaux. Son associé Miguel se charge de jeter un œil sur Baligand.
Dustin décide de me retrouver fin août pour la navigation de retour vers les Antilles. Tout est donc en place pour partir à la découverte de la terre des gauchos et de Maradona.
Buenos Aires – avril 2010
Suite ci-dessous…



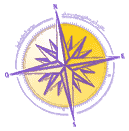








Argentina - Chili : BALIGAND apprécie le Tango et la Patagonie
Buenos Aires est une ville agréable. Quadrillée de larges avenues, aérée de parcs chatoyants. Les élégants immeubles parisiens du Centro contrastent avec les petites maisons de tôles ondulées peinturlurées de la Boca, berceau prolétarien du tango.
Buenos Aires, c’est surtout une atmosphère combinant une convivialité sud américaine bon enfant à un plaisir de vivre européen. C’est que le pays s’est construit sur l’immigration, surtout italienne, d’où un bordel ambiant de bon aloi, et allemande, qui fait que malgré tout cette société arrive à fonctionner.
Entre les deux, il n’y avait pas de place pour les amérindiens que les pères fondateurs de la nation ont pris soin de liquider.
Buenos Aires et le pays se sont construits sur de fabuleuses ressources agricoles. La Pampa peut produire jusqu'à trois récoltes annuelles et suffisamment de viande pour nourrir l’ensemble du continent .
La gabegie des gouvernants est incroyable. Le trait historique dominant est le détournement des richesses accumulées. La vie du pays est ainsi marquée de phases de grande prospérité suivies de faillites retentissantes. D’où une méfiance viscérale des Argentins pour tout ce qui touche de près ou de loin au pouvoir dirigeant, à commencer par les banques. Ils ont plusieurs fois ont vu leurs économies s’évanouir du jour au lendemain. Difficile dans ces conditions de créer les conditions nécessaires à un développement stable.
Le corollaire de cette situation est la violence des transitions politiques. Le passé récent des années noires de la dictature est là pour en témoigner. Une rencontre à la marina m’a d’ailleurs permis de prendre la mesure du traumatisme encore bien présent dans la société argentine.
Deux amies m’invitent à bord de leur petit voilier pour une ballade nautique sur le Rio de la Plata. Découverte fort agréable des canaux sillonnant le delta et des lieux de détentes privilégiés des « Porteños » : Tigre, San Fernando, San Isidro les faubourgs aisés du Nord. L’une des deux hôtesses, Isabella, médecin, blonde et jolie, dégage pourtant une infinie tristesse et parle peu.
Son amie, elle-même cardiologue, finit par m’expliquer son mutisme. Agée de trente-trois ans, elle a découvert voici trois ans qu’elle était enfant adoptive. Depuis lors, sa mère lui refuse toute explication quant à ses origines.
Trente-trois ans, le calcul est vite fait. La dictature militaire est en place et les tortionnaires martyrisent et tuent à peu près tout ce qui tombe sous leurs griffes. Les femmes enceintes sont souvent assassinées avec leur enfant, mais il est parfois donné à celui-ci de vivre. Se constitue ainsi une source d’adoption pour les couples bien en cour et en mal de filiation.
Alors, sa maman était-elle complice du régime, connaissait-elle ses parents naturels et qui étaient-ils ? Pour obtenir réponse la présidente Cristina Fernandez de Kirchner, élue avec le soutien des mères de la Plaza de Mayo a ouvert un centre où les parents des disparus peuvent déposer leur ADN et les citoyens dans la situation d’Isabella aller à la recherche de leurs origines. Elle ne s’est pas encore décidée à franchir ce pas.
Cela dit, Buenos Aires et l’Argentine ne peuvent se résumer aux seuls problèmes politiques et économiques. Les Argentins sont festifs, conviviaux, et amitieux. Un vrai régal à fréquenter. Les restaurants grillent à tour de brochettes, la viande succulente dont le pays ne saurait se passer, la musique anime la ville jusque tard dans la nuit et les Argentins boivent avec délectation leur maté.
Ce truc, il faut vraiment être tombé dedans petit pour l’apprécier. Comme le Marmite des Anglais ou le Sirop de Liège. Cela dit, ils sont comiques avec leur pot en étain rempli d’une herbe bizarre où trempe un embout qu’ils tètent avec délectation. On dirait des drogués, trimballant sous le bras un thermos rempli d’une recharge d’eau chaude. Les Argentins sont gens heureux.
Leurs voisins uruguayens paraissent partager le même bonheur de vivre, quoiqu’à un rythme plus tranquille. Colonia de Sacramento, de l’autre coté du Rio, à une heure de Buquebus, c’est un autre monde.
Vestige remarquablement préservé d’un établissement colonial du XVIIème siècle c’est aussi un lieu de seconde résidence prisé des Porteños. Deux cents kilomètres à l’est, la capitale Montevidéo offre l’image d’une bourgade tranquille gentiment assoupie le long des berges du Rio de la Plata. L’Uruguayen ne semble guère différent de son voisin d’en face. Même peuple de gauchos, même économie agraire, même parler bizarre où le « ch » remplace les sons en « ll » ou « y » et les « tu » et «vous » sont mis à la même sauce que « vos ». Il faut un peu de temps pour se faire a cette gymnastique.
Les « Uruguachos » sont gens simples. Il suffit de voir leur nouveau président, Pepe, qui dirige le pays quand la gestion de sa ferme lui en laisse le temps. Si tous les dirigeants monde avaient cette sagesse.
Bien sûr l’Argentine ne se résume pas au Rio de la Plata. Tout au Sud il y a l’immense Patagonie. Vingt-deux heures de bus tout confort et 1.600 Km à travers la Pampa et la steppe patagonne pour atteindre San Carlos de Bariloche, à l'Ouest du Pays, tout à coté du Chili, au pied de la cordillère des Andes.
On prend quelques montagnes suisses, une poignée de lacs américains, un zeste de glaciers nordiques et beaucoup d’arbres de Nouvelle Zélande, on ajoute du soleil et on saupoudre de chalets suisses en bois vernis pour obtenir une petite merveille. L’endroit est très touristique mais parfait pour partir en trekking jusqu'au glacier Tronador, naviguer sur les lacs, se promener dans les forêts et déguster le chocolat local.
Question andinisme - pas question de parler ici d’alpinisme - les pistes de ski ne sont guère impressionnantes et la station réduite à peu de choses, mais en été qu’importe.
Une heure et demi d’avion et mille kilomètres plus au Sud, en survolant les lacs glaciaires, le désert rocailleux et herbeux de la steppe patagonique, en longeant les hauts sommets et volcans des Andes on atteint El Calafate. C'est ici presque le fond du Continent. Le Pacifique, coté Chilien, est à cent quarante kilomètres, la Terre de feu juste en dessous plus à l'Est.
Calafate est une ville sortie d’un western, une sorte de décor planté récemment. Seul le centre est asphalté, les environs se parcourent sur des routes de terre. Les maisons construites sur les collines rases autour du lac glaciaire Argentino sont éparpillées comme implantées au gré de chaque nouveau colon.
C'est le pays de l’immense glacier continental, plusieurs fois la taille de la Belgique, à cheval sur le Chili et l'Argentine, qui se divise en affluents dont le plus célèbre, le Perito Moreno, à seulement quarante kilomètres du Pacifique, se découvre en bateau et s’explore à pied.
Coté pédestre c’est de la marche sur glacier, semelles pitonnées et piolet à la main, sinuant entre failles bleuâtres et crêtes blanchâtres. C’est aussi un parcours sur caillebotis qui fait face à l’impressionnante muraille que pousse le glacier jusqu'à la terre, fermant ainsi les eaux du bras Rico du Lac Argentino. Les eaux montent et érodent lentement cet obstacle naturel. Il faut entre deux et quatre années pour faire exploser l’extrémité du glacier. Évènement tellement spectaculaire qu’il passe en direct a la TV.
Coté bateau c’est un parcours de plusieurs heures à travers les glaçons de toutes formes pour atteindre le front des glaces : cinq kilomètres de large et une bonne centaine de mètres de haut. Le but du jeu est de repérer les blocs qui se détachent en permanence de la paroi et anticiper la détonation qui s’ensuit et la vague qui soulève le bateau. Aussi haut que porte le regard, le long parcours du glacier reste bien visible depuis les sommets. C’est un spectacle de toute beauté.
La Patagonie c’est aussi de gigantesques fermes qui tentent de survivre sur une terre si pauvre que trois hectares sont nécessaires pour nourrir un mouton. Le vent souffle régulièrement à plus de cent km/h et jamais il ne pleut, la barrière des Andes arrête la pluie des tempêtes venues du Pacifique qui tombe sur le seul versant chilien et les contreforts andins. C’est bientôt l’hiver et la région va s’endormir sous des températures de -20º. Il ne me reste plus qu’à entreprendre les quatre heures de vol pour rejoindre B-A, 3.000 Km au nord.
Nous sommes mi-avril. Pour naviguer vers le nord, il faut attendre la fin de l’hiver austral et les dépressions de sud qui nous pousseront vers les Antilles. Bonne raison pour aller voir du coté de l’Espagne comment s’annonce l’été.
Buenos Aires – avril 2010
Baligand est un vagabond en wallon liégeois.
Plutôt sympa ...




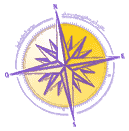
Baligand : la remontée de l'Amérique du Sud
Bonjour à tous,
La deuxième partie de la saison de navigation 2010 qui longtemps paru fort compromise, s’est pour finir révélée un excellent cru. 5.000 milles de navigation en 50 jours dont 32 en mer cela compte et cela se conte.
Malheureusement le tout est un peu longuet. Après tout l’histoire couvre quatre mois. Je l’ai donc divisée en trois épisodes distincts :
- Le retour au bateau en août 2010 avec quelques surprises.
- La découverte de quelques mythes argentins.
- La navigation de Buenos Aires aux Antilles.
Notre destination d’origine était Trinidad. Le retard pris au départ nous ayant fait arriver après la saison des ouragans, l’excuse était belle pour me rendre à la nouvelle base Amel en Martinique afin de leur confier les clefs du bateau et la liste des problèmes à résoudre.
Occasion aussi de prendre la grande décision de mettre Baligand en vente. L’objectif est atteint, le tour du monde est bouclé, l’aiguillon de ces neuf années de navigation disparaît. Il est temps de passer à autre chose.
Peut-être ne sera-t-il pas vendu aux Antilles. Dans ce cas nous nous retrouverons pour commenter une dixième année de navigation, celle du retour vers l’Europe via les Bahamas et les Bermudes. Ensuite on verra.
Ce sera soit la route Nord suivie en 2003 vers Halifax et la Nouvelle- Ecosse, avant de bifurquer à droite vers le Cap Breton et la traversée vers l’Irlande, soit le retour classique vers les Acores qui aurait le grand avantage de fournir un terrain de navigation propice l’été 2011 où initier la troisième génération aux plaisirs de la voile.
A bientôt.
Philippe
Partie 1) Des retrouvailles mouvementées
Au milieu du mois d’août, Buenos Aires atteint la perfection lorsque la pureté du ciel hivernal se nuance des premières touches printanières. Les retrouvailles avec Baligand s’effectueraient donc sous les meilleurs auspices si le plan d’eau où il se trouve n’était jonché de poissons morts.
A perte de vue, et celle-ci est impressionnante juché au sommet du mât, ce ne sont que scintillements de ventres argentés flottant en surface. Choc thermique causé par un hiver trop froid est l’explication officielle. Pollution généralisée du Rio de la Plata, semble plus proche de la réalité. Cela n’empêche quelques irréductibles de pêcher comme si de rien n’était. Pêcher quoi ? Une épuisette suffit à ramasser les cadavres !
Une autre spécialité locale est le « Sudeste ». Un coup de vent de sud-est, le redouté Pampero, pousse les eaux du fleuve en amont tout en noyant la ville sous des trombes d’eau. Le résultat est saisissant. Les quartiers riverains du fleuve se trouvent sous eaux, en ce inclus bien sûr les marinas dont les pontons deviennent inaccessibles si ce n’est à la nage ou en barque. Bonne occasion d’aller passer une soirée a l’hôtel en centre- ville.
Ces péripéties ne font pas oublier le but premier du retour au Centro Naval de Nuñez . Il faut préparer Baligand pour la longue navigation vers les Caraïbes. Mon jeune équipier Dustin traîne dans le coin depuis notre arrivée voici quatre mois et est dans les starting-blocks pour le départ prévu fin août.
En principe pas de problème. La coque n’a plus été passée à la peinture anti-fouling depuis deux ans, mais inspectée en plongée au Brésil elle était encore impeccable et comme depuis lors elle baigne dans l’eau douce du Rio, pas une bestiole n’a pu s’y accrocher.
Il convient toutefois de remplacer les anodes et donc sortir le bateau pour cette opération qu’il serait suicidaire d’effectuer en plongée parmi les poissons en putréfaction.
La darse du Yacht Club et la grue utilisée pour sortir le bateau n’inspirent guère confiance, mais bon, le grutier est convaincu de sa dextérité et puis c’est cela ou rien.
Résultat une angoisse pas possible lorsque nous parvenons à marée très haute à glisser Baligand dans la minuscule darse où l’espace disponible se mesure en centimètres, même pas la place pour glisser une défense.
Lorsque le portique extrait péniblement les 18 tonnes de l’eau, c’est pour s’apercevoir qu’une sangle a glissé et écrase le speedo mais surtout se rendre compte que la peinture de coque s’écaille de partout. Une horreur !
Que faire ? Une nouvelle peinture bien sûr mais à condition d’enlever neuf ans de vieilles couches accumulées. Le gérant du club, qui nous avait donné une heure, pas une minute de plus pour ce travail, ne veut rien entendre. « C’est un club privé ici, les membres sont en liste d’attente pour sortir leurs bateaux. Hors de question de vous donner priorité pour des travaux qui à vue de nez vont prendre un mois ».
Retour à l’eau donc tant que la marée le permet pour découvrir, clou sur mon cercueil, que de l’eau clapote à l’intérieur du bateau à hauteur du speedo assurément endommagé. Nous avons une voie d’eau !
Les options ne sont pas légions. Rares sont les marinas disposant de portiques de taille adéquate, presque toutes appartiennent à des clubs privés dont les membres sont en liste d’attente pour la toilette printanière de leur bébé et les artisans disponibles pour les travaux sont tous surbookés.
En attendant, l’horloge tourne et la saison pour entamer la remontée touche à sa fin. L’hiver est en effet propice aux navigations vers le Nord lorsque les vents dominants de Nord-est, et donc aussi les courants, sont moins puissants et les tempêtes de Sud plus fréquentes. Quant à mon équipier, il commence à trouver le temps long. Bien que de ce côté là, la jeune Sabrina qu’il vient de rencontrer devrait aider à gérer son impatience.
Par chance, une marina publique, Punta Chica, se révèle disponible et le gérant disposé à entamer immédiatement les travaux. Pas de problème pour sortir le bateau, assure-t-il. Bizarre quand même que son chantier soit étrangement vide. Mais quand on n’a pas le choix...
Reste à sortir Baligand de Centro Naval et l’amener à travers le dédale des canaux du delta jusqu’au Rio Lujan où s’alignent la plupart des marinas.
Miguel, qui s’est occupé de la garde du bateau, connait ces canaux comme sa poche et ne sera pas de trop pour nous guider à travers leurs méandres peu profonds... Inutile précaution car cinq heures plus tard, l’expert nous plante solidement dans la vase du Rio Urion et à marée haute s’il vous plait !
Une heure pour nous dégager grâce à la gentillesse d’un bateau de passage qui accepte d’aller jeter notre ancre, préalablement reliée par de multiples allonges à la drisse de grand mât.
Technique immuable: se déhaler sur l’ancre par le travers pour faire gîter le bateau jusqu'à ce que la quille se libère et sortir au moteur.
Oh que je ne la sens pas cette journée !
Et de fait, lorsque nous effectuons finalement notre entrée dans la Marina vraiment Chica (= petite), mes yeux incrédules découvrent l’accès suicidaire au portique de levage et croisent le regard mauvais du gérant qui décrète que son portique ne peut lever un ketch. Quoi ! Mais il le savait que mon bateau portait deux mâts !
Bon. Pas la peine de discuter, mieux vaut ainsi. On va s’installer à la marina et chercher une autre solution. « Non. La marina est pleine. Pas de place disponible ». Et voilà pourquoi le chantier de ce Boludo (= Enfoiré !) reste désespérément vide !
S’ensuit un échange plutôt vif où ma connaissance des explétifs argentins que le dictionnaire ignore et la bienséance réprouve est testée in situ. Il se conclut par une autorisation de séjour de 24 heures avant d’aller nous faire voir ailleurs.
Ou aller ! C’est le moment de battre le branle-bas de tous les Argentins sympas et marins, et Dieu sait s’il y en a, rencontrés depuis notre arrivée. C’est le cas de César Espigares qui va se mettre en quatre pour trouver une solution laquelle passera par son ami Benjamin Cosentino, ci-devant membre du directoire de l’YCA dont la base de San Fernando, à deux pas d’où nous sommes, dispose de tout l’équipement nécessaire.
En 24 heures, il nous trouve un amarrage, me suggère d’écrire sans délai au Commodore pour expliquer l’urgence de notre situation, après tout le bateau prend l’eau, et se propose d’appuyer personnellement notre demande.
Chose dite, chose faite et en moins de 48 heures, il nous est confirmé que le premier emplacement qui se libérera à terre nous sera disponible. Le 16 septembre, sept jours après l’introduction de notre demande, Baligand est hissé au sec sans autre drame. Je dois quand même à la vérité d’avouer qu’une inspection minutieuse de la coque permit d’établir que la voie d’eau salvatrice ne provenait d’aucune fissure, mais de l’usure d’un tuyau d’eau sanitaire interne. Bon, passons...
Reste à trouver le Saint Graal du marin : l’entreprise compétente qui effectuera sans délais et avec un minimum d’arnaque un travail dans les règles de l’art... Impossible... Et de fait les premiers contacts confirment mes pires craintes, certains suggérant d’attendre la saison prochaine, aucun n’offrant aucune garantie de délai et tous confondant joyeusement urgence avec désespoir et budget avec puits sans fonds.
Il est vrai que décaper les couches accumulées depuis, heu..., la livraison du bateau va être tâche de patience et longueur de temps. C’est alors que surgit l’homme providentiel : Eugenio. De descendance anversoise, il est ravi d’échanger quelques paroles dans le patois qu’ils parlent là-bas, avant de m’informer que sa petite entreprise construit des bateaux, est un peu en panne de commande et qu’il serait enchanté de me remettre prix.
Comme en Argentine tout se transige en obscure cash, il ajoute qu’il doit se rendre en Belgique et que l’argent pourrait lui être remis là-bas, évitant le problème récurrent de faire cramer mes cartes de crédit aux distributeurs de billets locaux.
Il assure pouvoir faire les travaux en douze jours, ce que je juge utopique, et accepte une pénalité par jour de retard... Il mettra quinze jours pour remplir son contrat grâce au dévouement de son jeune assistant Julian et à la présence constante de Juan, le fournisseur des peintures Hempel qui essaie de se faire une place dans un marché dominé par la marque International.
Partie 2) A la découverte des mythes argentins
Les règles de l’YCA interdisant de loger à bord d’un bateau en chantier, il me faut transplanter mes pénates dans une pension de San Fernando. Bonne occasion, tout en assurant en relais avec Dustin la surveillance indispensable des travaux, de partir à la traque des grands mythes argentins, à savoir le Vin, le Tango, les Gauchos et le Polo.
La Mecque du vin en Argentine, c’est Mendoza au cœur d’une région qui concentre 90% de la production du pays et dont l’alter ego chilien se prolonge sur l’autre versant des Andes. Région bien improbable pourtant à 1.500 km de Buenos Aires, tout au bout de la Pampa sèche dont les terres arides adossées à la cordillère s’abreuvent aux eaux glaciaires qui en descendent. Pas de neige, pas d’eau.
Les grandes exploitations alignent sur des hectares les cépages de malbec, cabernet-sauvignon, syrah voire de tempranillo espagnol ou de bonarda piémontaise pour les rouges, de chardonnay et de sauvignon pour les blancs.
Comme l’essentiel de leur production et leurs meilleurs vins sont réservés à l’exportation, ces vignobles sont peu intéressés à ouvrir leurs portes aux touristes. Restent les petits producteurs dont la visite, qui se dit informative, tourne vite à la promotion Tupperware. Bref pour découvrir les secrets de ce terroir une approche plus intimiste et d’avantage de temps seraient nécessaires. Mais comme il existe près de 1.700 exploitations...
Non, outre la ville vivante et sympathique, l’intérêt de cette région se trouve plus loin, sur la route des Andes empruntée dans un sens par les espagnols au XVIème siècle sur le chemin de la conquête et dans l’autre en 1817 par le général Saint Martin, héros de l’Argentine et du Pérou, sur la voie de la libération.
Cette route qui relie Buenos Aires à Santiago en grimpant à 3.200 m, révèle de superbes canyons et paysages de montagne. Peu de neige dans un environnement froid et très dépouillé où règne en maître le seigneur Condor qui partage la vedette avec l’Aconcagua, le toit du continent, déployant la majesté de ses 7.000 m sur fond de ciel bleu d’une pureté absolue. Somptueux spectacle.
Marta, la gérante de la pension où j’ai pris résidence est Milongera, danseuse de Tango quoi ! Attention pas ce tango qui vend chèrement ses charmes sensuels dans les spectacles pour touristes où qui exhibe la froide beauté de danseurs gominés/maquillés dans les rues piétonnes de Buenos Aires ou à la Boca. Non le vrai, le pur, au culte duquel peuvent seuls se consacrer les membres de la secte admis au saint des saints, la Milonga.
Pour participer le grand uniforme est requis : noir de la tête, dénudée (pas de couvre-chef fantaisie svp), jusqu’aux pieds engoncés dans des pompes vernies, en passant par la large ceinture tout aussi noire.
Comment Marta est parvenue à me faire admettre en ce lieu sacré avec mes docksides jaunes et pantalon rando reste un mystère. Dénoter, vous dites... ! Le mot est faible.
Le « temple » ne paye pas de mine. Un grand rectangle dénudé, style salle des fêtes et pas d’orchestre. « Non, un orchestre trahirait la manière pure de jouer des artistes qui créèrent le genre dans les années 30 ». Interdiction de toucher aux enregistrements originaux qui passent donc en boucle.
Les Milongeros, qui consacrent leur vie à cet art noctambule sont des seigneurs âgés et distants qui accordent aux Milongeras de leur choix la faveur de les conduire. Faveur qui serait retirée à jamais si l’élue avait la malencontreuse idée d’accepter une offre concurrente qui pourrait polluer le style personnel dont le maître imprègne les membres de son écurie.
Étrange rituel ou l’érotisme du geste est contredit par la froide indifférence dont se parent les danseurs. Le tango n’est affaire ni de drague, ni de séduction mais plutôt d’un combat dont les enjeux sont la domination et la soumission. Un vrai spectacle de vie dont les adeptes ont essaimé dans les plus grandes villes du monde.
San Pedro, est une bourgade touristique le long du fleuve Paraná au nord de Buenos Aires. Ce dimanche y a lieu un rassemblement de gauchos qui, pour l’évènement, exhibent fièrement les harnachements finement ouvragés de leurs instruments de travail et arborent leurs plus beaux atours : pantalons bouffants, larges ceintures de cuir où se glisse la navaja (long coutelas recourbé), chapeaux à bords mous ou boïna (béret) basquaise, bottes de cuir.
Les grillades répandent leur fumet, la bière coule à flot. Ambiance de fête gitane. La raison de ce raout campagnard est la Doma (épreuve de domptage), épreuve initiatique où les jeunes Jinetes (cavalier) doivent imposer leur volonté et surtout leur présence sur le dos d’un Potros (jeune cheval jamais monté) à priori pas du tout d’accord.
Les poulains encore sauvages sont amenés à un poteau, solidement attachés, les yeux bandés pendant que deux courageux leur fixent un harnachement qui n’a guère l’air de les ravir.
Déjà le cirque commence. Ils se jettent au sol, font milles cabrioles autour du poteau et finissent par se retrouver dans une position pas possible, cou
tordu, étranglés par la longe. Et le cavalier n’a pas encore mis le pied à l’étrier, ce qui est l’étape suivante tout aussi spectaculaire.
Quand le courageux est enfin en selle, main droite bien calée dans une sangle, au signal, c’est le lâcher tout. Et je saute, je cabre, je rue, je fais tout pour me débarrasser de l’importun, dans une course incontrôlée dont la seule conséquence est d’effrayer le public, mais point le Jinete qui, en général, atteint la limite des quinze secondes fatidiques avant qu’un autre cavalier l’aide à quitter l’inconfort de sa position.
Pendant ce temps l’organisateur de service chante ses commentaires et lance des vannes au public en s’accompagnant à la guitare. Belle ambiance rurale à l’abri des touristes, beau spectacle et belle démonstration qui en dit long sur la maestria équestre des gauchos.
Le polo, c’est la démonstration des mêmes qualités équestres, côté rural en moins. A une trentaine de kilomètres de Buenos Aires, dans un barrio privado * ultra select s’alignent tentes VIP. Bars à champagne, présentoirs de bagnoles de luxe, pubs pour tout ce qui touche à l’élégant inutile et un public distingué très smart-chic.
De nouveau, mes pompes jaunes et pantalon de baroudeur font recette. Ici les gauchos servent d’assistants pour bouchonner les chevaux, les échauffer, les harnacher et les tenir à disposition pour changements de monture au vol en cours de partie.
Justement, parlons-en de cette partie. Deux équipes de quatre joueurs et deux arbitres sur un terrain immensissime. Au moins quatre terrains de foot. Un marquoir aide bien à suivre le score mais pour ce qui est de distinguer la petite balle et les petits joueurs sur leurs petits chevaux tout au loin là-bas, bonne chance.
De temps en temps, le hasard déplace le jeu vers le coin des tribunes où je me trouve. La violence de la cavalcade, la puissance des animaux lancés au grand galop, le choc des maillets, les claquements des sabots à l’unisson, l’adresse extrême des cavaliers forcent admiration et émoi.
On se prend à imaginer combien terrifiantes devaient être les charges de cavalerie d’antan. Mais bon, ces moments sont rares et la partie bien longuette ne suscite que rares moments intenses parmi un public de connaisseurs, composé surtout de parents et amis. Il est vrai que nous sommes entre Caballeros.
Ah oui un détail, lorsque l’on a compris la règle de jeu inversant les en- buts après chaque score, on cesse de se demander pourquoi chaque équipe s’obstine à marquer contre son camp.
Une version rurale de ce sport existe sous le nom de Pato. Semblable au Buzkashi Afghan, il se dispute sur un terrain beaucoup plus petit et l’objet du désir est une balle pourvue d’anses (non, il n’est plus permis d’utiliser la tête décapitée d’un adversaire). Beaucoup plus vif et rapide, c’est le sport des gauchos et l’ambiance autour du terrain y est un brin différente.
*Barrio Privado : quartier privé, barricadé et gardé de plus en plus populaire parmi les classes aisées qui désirent s’isoler et se protéger de la délinquance croissante.
Partie 3) La navigation enfin : Buenos-Aires -Martinique - 5000 milles nautiques
Donc, le 9 octobre Baligand, coque repeinte à neuf, retrouve son élément naturel et vogue deux jours plus tard à travers les canaux, vers le centre de Buenos Aires. Pas de soucis cette fois, Jorge, oncle de notre nouvel équipier Mauricio, nous apporte sa vraie connaissance du delta ainsi qu’un amarrage de cortesia, traduisez gratuit, pour un court séjour à Puerto Madero.
Ah Mauricio! Dustin me l’avait amené. Co-gérant de l’auberge de jeunesse où Dustin s’était installé, il en avait fait son pote de virée et son poisson-pilote à la découverte du monde nocturne de B’aires. Mauricio rêvait - c’est sa spécialité - de grands espaces, de navigation, de quitter l’Argentine et d’entamer une vie d’aventures.
Comme je le découvrirai par la suite, Mauricio tient du paresseux (l’animal) dont il partage le geste lent, hésitant, la tête penchée cherchant à comprendre le sens de l’instruction qui lui a été donnée et dans le doute, s’abstenant de l’exécuter.
A 36 ans, Mauricio n’a pas un rond et pas de perspective d’en avoir, mais il a un trésor: un regard triste, un peu suppliant, une gentillesse perceptible au toucher qui fait fondre les cœurs les plus endurcis. C’est le truc qui lui permet vivre à charge des autres sans que jamais l’on puisse lui en vouloir.
Il réussira quand même l’exploit pendant son séjour de ne jamais rien débourser et de se faire payer son retour à Buenos Aires. Mais j’anticipe. Pour l’heure Mauricio à des sous, empruntés à son oncle ce qu’il ne nous a pas dit, et notre équipage est formé.
Buenos Aires – Rio do Janeiro – 1.240* (1.135**) milles – 8 jours
Départ prévu pour le 14 octobre sans faute, car une dépression de Sud est annoncée, évènement rare aussi tard dans la saison. Derniers adieux pas trop déchirants, dernière virée à Buenos Aires, derniers avitaillements. De ce côté-là pas de problème, le congélateur regorge de plats pré-cuisinés par Marta qui pousse ainsi à l’extrême le concept du All Inclusive.
Prêts, nous le sommes. Non ! Dernier avatar. En faisant tourner le lave- linge pendant les courses, le programme s’est bloqué et la pompe a tourné non-stop déversant les 1.000 litres du réservoir d’eau douce dans le bateau. En urgence il faut pomper l’eau, vider les fonds, mettre à sécher ce qui le peut et jeter ce qui ne le peut pas.
Bon, faut pas s’en faire, ce n’est jamais que le premier souci d’une liste qui sera, sans nul doute, longue. Encore faut-il, le 14 matin, effectuer les formalités douanières-policières-portuaires qui ne peuvent précéder la sortie du pays que de deux heures, afin de se présenter devant le pont-levis fermant la darse de Puerto Madero à 10 heures précises.
Skipper, heureux d’enfin naviguer, et équipage partagé entre inquiétude et excitation regardent s’éloigner le skyline de Buenos Aires. Reste à guetter l’arrivée du fameux Pampero. Qui ne se fait guère attendre. Nous allons à l’Est, il souffle du Sud-ouest. Combinaison parfaite pour nous pousser, dans la nuit noire et sous les trombes d’eau qu’apporte ce vent pour prix du service rendu, vers la côte Uruguayenne.
Hauts fonds et trafic intense ajoutent un brin d’intensité à cette remise en main musclée. Punta del Este, la porte de l’océan est atteint au matin. La tension à bord décroit avec le vent et chacun commence à trouver ses marques.
Quarts de jour, quarts de nuit, deux fois quatre heures chacun, de quoi se reposer, sauf urgence, huit heures d’affilée. Un vrai luxe. Quarante-huit heures de petit temps s’ensuivent, suffisantes pour atteindre la frontière brésilienne puis Rio Grande do Sul avant qu’une nouvelle dépression - nous sommes vraiment vernis - nous emmène en deux jours jusqu'à la hauteur de l’ile de Santa Catarina (Florianopolis).
Le courant, qui descend en sens contraire, a la gentillesse de ne pas nous repousser avec trop de vigueur. Le cap suivi vise Cabo Frio, la pointe de l’immense baie où s’enchâssent Santos et Rio, dans l’espoir de nous réfugier à Buzios, le Saint Tropez local, prêts à profiter de la dépression suivante.
Oui mais Eole a décidé de reprendre ce qu’il avait si généreusement octroyé. Plus de vent, ou si peu. Recours donc à l’assistance de la brise Volvo et obligation de s’arrêter à Rio pour refaire du gasoil. Mes équipiers qui rêvaient d’une entrée dans la plus belle baie du monde sont ravis.
En quatre jours nous allons visiter les trois chapelles maritimes qu’offre chichement la cité carioca. Nous commençons par la Marina da Gloria car située au centre-ville donc idéale pour effectuer sans délais (nous sommes vendredi après-midi) les redoutables formalités d’entrée au Brésil.
Mauricio, qui maîtrise l’idiome local, ayant vécu quinze ans à Sao Paulo, va se révéler une aide précieuse pour nous retrouver dans ce maquis contradictoire.
« Formalités sanitaires ? » « Tout au bout du port ! » « Non de l’autre côté » Regards incompréhensifs des fonctionnaires jusqu'à rencontrer celui qui sait... que cette démarche n’est plus nécessaire.
Douanes. Ça y est, trouvé ! « Quoi, il faut d’abord faire l’immigration. Pas ce que la marina nous avait dit ! C’est où ? » Bon on y va. «Voilà, le grand bâtiment à gauche» « Non, ici nous ne traitons pas les voiliers » « Ou alors ? » « Au terminal des paquebots » Ce n’est pas vrai, ils doivent avoir des actions dans les taxis !
Effectivement au terminal une brochette de jolies filles nous tamponne les passeports sans autre formalité que leur sourire Colgate. Un voilier, quoi de plus naturel ! Un Belge, un Américain et un Argentin. Bien sûr. Bang, bang. Bienvenue dans notre beau pays !
Incroyable. Les Brésiliens doivent avoir monté une opération « Accueillons sympa » contre nature en vue des J.O et du Mundial. Retour douanes. « Non, d’abord la capitainerie du port !» «Vous vous fichez de nous ! On en a marre de parcourir la ville » « Bon exceptionnellement …» .
Durant deux heures, Mauricio va devoir se taper le blabla du fonctionnaire avant que le précieux sésame soit délivré. Reste la capitainerie militaire ouverte 24 heures sur 24 et donc fermée à 18 heures.
« Le responsable est parti.» « On s’en fout, nous repartons demain. Allez le chercher » Une heure de plus et enfin nous pouvons aller nous asseoir, épuisés, à une terrasse du quartier de Lappa.
Le lendemain, évaluation des bobos de la première étape. Les rivets du pied d’enrouleur de génois, remplacés à l’YCA, sautent les uns après les autres. «Vous ne trouverez pas une riveteuse de cette taille au Brésil» Ben tiens. Dustin bricole donc un collier de serrage. Un toron d’un hauban du mat de misaine est sectionné. «On peut vous le remplacer par un hauban complet made in Brazil. Délai douze jours, coût 1.000 $ ». Bien sûr. A notre avis il n’y a pas danger de rupture, mais par sécurité nous fixons en renfort une drisse sur un palan triple brin.
Reste à faire le plein. Destination le Iate Club de Rio do Janeiro au fond de la baie de Botafogo où effectivement nous parvenons à distinguer une pompe. Mais trop peu d’eau et une approche vraiment peu avenante. De plus un orage nous tombe dessus. Le temps de nous sortir du maquis de bateaux sur corps morts, l’ancre est jetée pour une nuit pluvieuse au mouillage. Toujours moins cher que les 80 euros de Marina da Gloria.
Le lendemain, traversée de la baie vers Niteroi et le Clube Naval Charitas histoire de revoir le sourire de Suzy et Renato qui nous informent que juste en face une station de gasoil s’est ouverte au Iate Club Brasileiro. Mes jeunes équipiers en profitent pour effectuer une escapade nocturne.
«Mauricio, ne crois tu pas plus prudent d’économiser tes sous » « Pas de problème » répond-il en tapotant l’épaule de Dustin « J’ai mon sponsor » lequel manque de s’étrangler devant tant de candeur innocente...
Tout est donc paré pour la deuxième étape.
* distance réellement parcourue sur l’eau compte tenu du courant
** distance sur le fonds = distance mesurée en ligne directe sur la carte
Rio do Janeiro – Salvador do Bahía –1.100 (740) milles – 7 jours
Mardi 26 octobre, la chance continue à nous sourire. Un petit vent de sud-est est prévu, suffisant pour permettre de doubler Cabo Frio, 70 milles à l’Est, et y attendre une bonne grosse dépression.
De fait, au milieu de la nuit, alors que nous bouchonnons, maudissant les prévisionnistes, de gros rouleaux sombres remplissent le ciel et nous emportent puissamment vers le Nord. Pas pour longtemps. Au petit matin la tempête, trop pressée, nous a dépassés ne laissant qu’un souffle pour grimper en une journée vers Cabo Sao Tome et Vitoria.
A l’aube du troisième jour, le port de Vitoria nous trouve sans vent et sans envie de nous y arrêter. C’est ici le terminus dépressionnaire. Tout le monde descend. Déjà en plein hiver elles ne remontent pas beaucoup plus Nord, alors au printemps...
Il faut prendre son mal en patience et attendre le retour du vent dominant de Nord Est, précisément là où nous voulons aller. Il ne tarde pas à arriver et commence l’exercice détesté des marins : tirer des bords.
Quinze à vingt nœuds de vent, bateau sur la tranche, on oscille entre le bord de l’espoir, qui nous rapproche du but, et celui du désespoir qui nous en éloigne cruellement. Pénélope est à l’ouvrage qui démaillait le soir ce qu’elle avait tissé la journée, sauf que pour nous, à force de calquer nos virements sur les variations de vent prévues, la toile fini par prendre forme.
Pour corser les choses l’archipel des Abrolhos se dresse sur le parcours et doit être contourné par l’est, réduisant notre marge de manœuvre. Deux jours seront nécessaires pour dépasser ce sanctuaire aviaire, dont, en d’autres circonstances, nous aurions apprécié le mouillage abrité.
C’est la zone où abondent les baleines, et même si en ce début d’été austral elles ont commencé leur migration vers le Sud, quelques traînardes acceptent de nous divertir.
Au matin du septième jour profitant d’une imperceptible adonnée du vent à l’Est, un énième bord nous ouvre la porte de la baie de tous les Saints. Pas question d’hésiter, voiles légèrement arisées, Baligand fonce à 9 nœuds au près très serré, étrave obstinément pointée vers le Terminal Nautico où nous l’amarrons à la tombée de la nuit, recoupant notre sillage tracé le 28 mars 2009 lors de notre arrivée d’Afrique du Sud.
Côté bobos, les plus graves sont les déchirures du génois, presque normal dans ces conditions d’utilisation, du spinnaker de misaine et du ballooner. Retour chez Eduardo de North Sails qui commence à bien connaître ces voiles. Elles seront prêtes lundi, dans six jours.
Nouveau départ mardi 2 novembre. Caramba, la pompe WC fuit, créant une entrée d’eau et l’enrouleur de génois fait un bruit de crécelle pour cause de manque de graisse à l’intérieur du profilé m’écrit Amel.
L’inévitable Marcelo se propose de faire le travail, mais j’ai trop d’instinct de survie pour lui confier quoi que ce soit. Marcelo, quand on connaît son système, c’est presque un plaisir de le voir à l’œuvre. Idéalement situé dans une des premières marinas qu’abordent les voiliers en provenance d’Europe, il est prompt à les accueillir, avec le sourire et en anglais, à écouter les malheurs qui leur sont forcément arrivés et à proposer dans l’instant une solution. Si le naïf sous le charme s’en remet à lui, un premier travail sera entamé qui attendra longtemps avant d’être mal poursuivi à des prix défiant la décence.
Au Terminal Nautico, se trouvent trois Amel, arrivés l’année précédente avec le rallye des Iles du Soleil dont l’un est en vente et deux ont touché, à six heures d’intervalle, la même roche au Morro de Sao Paulo. Bilan pour l’un d’eux, quille voilée et nouveau mât fourni par Amel à l’intermédiaire de Marcelo qui ne quitte plus leurs bords. Les Pôvres.
A dix milles au nord, dans la baie d’Aratu, Pierre Préjean, rencontré l’an dernier, poursuit la construction de Marina Ocema. Belle occasion d’y déplacer Baligand loin du bruit de la ville. L'endroit dispose d’un ponton et trois autres sont en projet pour un total de 300 emplacements.
Pierre s'est associé à Philippe Prouvost, constructeur des catamarans Dolphin à Aracaju. La production à destination du marché US, s'est arrêtée voici deux ans. Philippe va sans doute prendre en charge la gestion de Marina Ocema et s'occuper des prestations de maintenance tout en relançant une production de bateaux. L’objectif commercial est bien sûr les voileux en provenance d’Europe à la recherche d’un séjour long terme avec services d'entretien et de réparation d’une autre qualité que ceux de Marcelo. Nul doute que vu leur localisation, si le financement suit, ils réussiront.
Entretemps Dustin et Mauricio en grande soif de tendresse ont décidé de lancer une expédition de deux jours sur les bars et plages de Barra, l’endroit où nous nous étions fait sauvagement agresser l’an passé. Rien donc qui puisse me rassurer. Heureusement, dimanche soir les voit revenir pas trop sains mais saufs.
Le lendemain, utilisant le véhicule prêté par Pierre, l’avitaillement est réalisé, les voiles récupérées et les formalités de sortie expédiées.
Salvador do Bahia – Joao Pessoa - 680 (465) milles – 4 jours
Départ ce 9 novembre à l’aube. L’heure est dictée par la marée haute requise pour sortir de la marina. La descente de la baie de tous les Saints et le long bord pour se mettre à distance respectable de la côte seront les rares moments de confort sur ce parcours sans concession.
Quoique court sur papier, l’obligation de tirer des bords va l’allonger de 50 % car il n’y a rien à espérer du vent. Les alizés bien établis soufflent sans discontinuer du nord-est, cap imposé par le profil de la côte au moins jusqu'à Recife.
Recommence donc, pendant trois jours, l’exercice auquel nous sommes maintenant bien entrainés : tirer des bords et vivre sur la tranche. Pas suffisamment entrainés toutefois car Mauricio a le mal de mer. Il faut admettre que vivre dans ces conditions amortit les activités de tout un chacun. Rien que faire du café requiert une planification sérieuse et une exécution longue sans garantie que le breuvage arrive intact à son destinataire.
Pour la nourriture, des plats préparés en ravier ont été embarqués. Il suffit de les réchauffer au four monté sur cardans. Le micro-ondes, qui ne l’est pas, restant interdit d’utilisation dans ces conditions. La partie acrobatique est plutôt du côté de la dégustation des mets dans le cockpit qui semble soudain habité de parkinsoniens.
Côté repos, difficile de parler de relaxation, ceux dont la couchette est au vent attendent avec espoir le virement de bord qui leur apportera un peu de confort. Lorsque le skipper appelle la manœuvre alors qu’ils sont de quart, et ne pourront donc profiter du changement, leur déception fait peine à voir.
Facteur supplémentaire à intégrer dans les décisions à prendre. Baligand navigue au près à 45° du vent, 50° lorsque le cap le permet. Sous cet angle l’étrave part à l’assaut de la vague, monte sur la crête et retombe parfois sur la suivante ou... tombe dans un creux. Ce crash dont on ressent l’imminence lorsque le bateau se trouve comme suspendu en l’air s’accompagne d’un bruit comme un coup de canon et d’un choc qui fait vibrer le bateau de la quille au sommet du mât. Dans ces moments, auxquels on ne s’habitue jamais, j’ai toujours une pensée émue pour Monsieur Amel et la solidité de ses bateaux.
Une autre version de ce genre de délassement est les coups de butoir de la mer sur la coque. Parfois le choc est si violent que la vague prend son envol et dans la foulée écrase quelques tonnes d’eau sur la capote et le pare-brise. Mieux vaut ne pas être a l’extérieur à ce moment.
Tous ces menus plaisirs font qu’au bout de trois jours, presqu’à hauteur de Recife, lorsque la côte commence à s’orienter vers le Nord et que le cap suivi permet d’ouvrir l’angle de navigation, personne n’objecte au confort retrouvé. Bateau un peu plus à plat et chocs moins violents, équipage content. Ceci permet également d’atteindre sur un seul bord et en une journée le port de Cabedelo à l’embouchure du Rio Paraíba où se trouve Jacaré, notre destination.
L’ambiance est ici toute différente. La végétation devenue tropicale longe le rio que sillonnent les voiles colorées des barques traditionnelles. Autour du ponton unique de la petite marina du Français Philippe, s’alignent les « Yate Club » dédiés à la plaisance motorisée.
La rivière est un lieu de villégiature pour touristes brésiliens ce que confirme la foire tonitruante de bars, restaurants et échoppes diverses installée tout à côté. Ceci n’empêche le petit village de Jacaré, rues ensablées et soleil de plomb, de respirer calme et sérénité. J’y découvre un autre Brésil sympa, convivial et bon enfant qui me convainc que le meilleur du pays se trouve dans le Nord.
Joao Pessoa, capitale de l’état de Paraíba, à une vingtaine de kilomètres de Jacaré, est une ville d’importance. Quartier historique bien conservé, centre-ville animé de beaux immeubles autour d’un lac central, architecture futuriste du centre universitaire réalisé par Niemeyer sur les falaises du Cabo Branco* au pied duquel s’étalent de belles plages balayées d’embruns, lieux de vie essentiels pour les Brésiliens. Les immeubles poussent comme herbe folle, témoins du développement rapide de cette région où, chose rare au Brésil, on se sent en sécurité.
Il n’en faut pas plus pour que Mauricio et Dustin partent à la découverte des ressources culturelles du pays, les fringues féminines et surtout leur contenu ainsi que toutes formes de boissons fermentées.
C’est le terminus pour Mauricio. Il a son plan: je lui paye son retour jusqu'à Salvador d’où il se rendra en avion à Sao Paulo grâce aux miles gratuits extorqués à un copain. Il y logera chez des parents jusqu'à ce que de guerre lasse, ils lui payent son retour à Buenos Aires où il a déjà convaincu des copines d’organiser « una fiesta » pour célébrer son retour triomphal qui fera pendant à celle organisée il y a peu pour pleurer son départ définitif...
* Cabo Branco : Cap Blanc - Le point le plus à l’Est du continent Sud-Américain
Joao Pessoa – Cayenne – 1.170 (1320) milles – 8 jours
Dustin et moi sommes seuls à bord le 17 novembre à l’entame d’une longue étape qui va dérouler 8 jours de rêve. Comment décrire le bonheur pur ? Vent de travers constant de 15 à 20 nœuds, Baligand glisse sans discontinuer sur une mer plate. Doux bruit des filets d’eau qui filent le long de la coque, quarts de nuit enchanteurs, journées de lecture oisive dans la brise et la chaleur, observation lascive du jeu des dauphins sous l’étrave, couchers de soleil-excuses pour siroter le cocktail bateau : cachaça – maracuja – sucre – miel et glace.
Bref tellement beau et tellement rare qu’on en regrette presque le puissant courant qui nous pousse au-delà de 10 nœuds et raccourcit d’autant notre plaisir. Après le départ 120 petits milles suffisent pour atteindre Cabo do Sao Roque, juste au-dessus de Natal, la corne du Brésil à partir de laquelle la route s’infléchit Nord-Ouest.
L’archipel de Fernando do Noronha est laissé loin à l’Est, Fortaleza ignoré 200 milles plus loin tout comme Sao Luis, Belém et l’immense embouchure de l’Amazone. Le 21 novembre à 14 heures Baligand traverse pour la quatrième fois l’équateur. Pour Dustin c’est une première et il sacrifie à Neptune un peu du champagne brésilien qu’il a acheté. Erreur il aurait du faire don du tout, ce qui lui aurait évité une sérieuse colique.
Le 24 novembre en soirée nous quittons les eaux brésiliennes dans lesquelles nous étions entrés le 16 octobre. Ce pays est immense et donne l’impression de ne jamais finir. Au matin du huitième jour le rêve prend fin, nous embouquons à marée haute la rivière Mahury pour nous amarrer huit milles plus loin au ponton de la marina Dégrad des Cannes en Guyane Française.
Marina! Appellation grandiose pour ce ponton non entretenu où s’accrochent des bateaux ventouses, certains dans un état pitoyable, beaucoup ayant renoncé à tout espoir de navigation. De manière mystérieuse eau et courant fonctionnent et encore plus troublant, nous trouvons à nous amarrer directement au ponton grâce a l’aide aimable d’un français dont le bateau est en résidence depuis janvier.
L’endroit est isolé à 10 Km de Cayenne et la voiture indispensable. Kourou, où se trouve le centre spatial de l’ESA et les îles du Salut, est distant de 75 Km. Mauvaise nouvelle les îles et le centre sont fermés, bonne nouvelle c’est pour cause de lancement. Direction Kourou donc où à l’heure dite s’offre le spectacle unique de la fusée Ariane traçant son sillon de fumée au-dessus de îles du Salut (qui n’en offraient guère). Le plus impressionnant dans ce lancement c’est le décalage du bruit qui met un certain temps à atteindre les oreilles des spectateurs alignés à l’embouchure du fleuve Kourou et monte dans le ciel à la poursuite du panache.
Pour le reste Cayenne est une petite ville assoupie aux relents coloniaux forts plaisants. La jungle amazonienne est à deux pas où découvrir caïmans noirs et autres singes nasiques. Les ballades dans la forêt sont à portées de basket où peuvent s’observer les paresseux en inaction. Tiens un cousin de Mauricio. Le climat est chaud et très humide d’autant que les premières gouttes de la saison des pluies commencent à tomber. Mieux vaut ne pas s’attarder.
Cayenne – Martinique – 780 (770) milles – 5 jours
Le 3 décembre, nous quittons Cayenne pour une destination qui serait nord-ouest s’il n’y avait à passer la Zone de Convergence Inter Tropicale* qui pour se négocier au mieux requiert de naviguer vers le Nord. Tant mieux car les vents sont faibles et ce cap nous permet d’en tirer meilleur profit entre près et travers.
Quand même, ils sont faibles et variables et requièrent une attention constante. Le climat est très lourd et l’ambiance à bord s’en ressent. La fatigue de 45 jours de voyage commence à peser.
La zone est atteinte par 9°30 Nord après deux jours de navigation. Elle est peu active mais assez étendue et il faudra 9 heures pour la traverser sous un déluge assez inoffensif, si ce n’est le manque de visibilité absolu car, bien évidemment, il fait nuit. Au sortir nous pouvons enfin prendre une route directe vers la Martinique.
Erreur ! Le ciel reste couvert et quelque chose cloche. En fait, la zone se déplace avec nous et nous rattrape au bout de quelques heures par 10°30 Nord avec cette fois le show complet, pluie et éclairs d’une violence inouïe.
Depuis Panama et notre épisode avec la foudre c’est ma terreur. L’angoisse ne dure que quatre heures et cette fois nous sortons dans un ciel bien dégagé. La zone bien visible sur l’arrière maintient sa course vers le Nord nous laissant poursuivre notre route. Les vents se reconstituent et enfin nous touchons les alizés de Nord-est qui nous emmènent à destination dans le grand confort.
La Barbade est longée le quatrième jour et l’aube du cinquième voit les pitons de Santa Lucia apparaître sur bâbord tandis que le Diamant martiniquais pointe devant notre étrave. Le cul de sac du Marin et sa marina nous accueillent ce 3 décembre 2010 comme ils le firent le 25 décembre 2001. La boucle est bouclée, le tour du monde est bel et bien terminé.
* Zone de convergence – ITCZ en anglais - est l’endroit où les basses pressions équatoriales australes et boréales se rencontrent. Zone caractérisée par l’absence de vent et des nuages gigantesques qui s’élèvent jusqu'à 15.000 mètres d’altitude déversant avec violence éclairs et pluie. C’est là que s’est crashé l’Airbus d’Air France en 2008.
Dernières MàJ du site : Avril 2024

